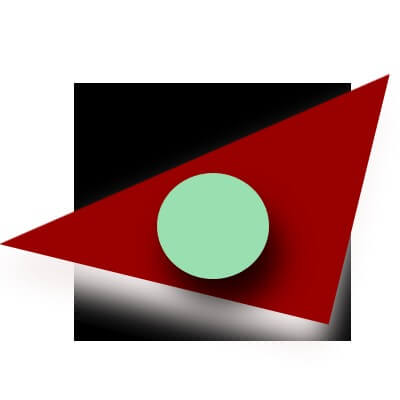Colloque « Quel management demain ? »
par Philippe Bernoux
directeur de recherche honoraire au cnrs-université Lyon 2
L’anthropologie dans l’enseignement en management :
la reconnaissance sociale
Résumé
Le malaise social qui se manifeste aujourd’hui dans les entreprises révèle une crise de la pensée managériale, due à une connaissance plus que sommaire de l’homme au travail et à un usage mal maîtrisé des outils de gestion. On rappellera un des principes fondamentaux de l’anthropologie, à savoir que toute société est fondée sur la reconnaissance sociale des hommes entre eux. Ce principe permet de comprendre une des manifestations les plus violentes du malaise social, le phénomène du suicide. La mise en place des outils de gestion devra prendre en compte ce principe au lieu de s’appuyer sur des représentations sommaires de la nature humaine.
Abstract
The social trouble which appears todays in companies reveals a
crisis of the managerial thinking which is due to a lack of knowledge of
men at work and also to uncontrolled of management tools. One of the fundamental
principles of anthropology is that every society is based on the social
recognition among men. This principle enables us to understand the
most violent expression of this trouble : the phenomenon of suicide. The
implementation of management tools should take into account this
principle rather than relying on rough representations of the human nature.
Les évènements récents qui se sont produits dans les entreprises (malaise social, suicides) et les orientations managériales induites depuis une vingtaine d’années par les nouveaux outils de gestion, invitent à s’interroger à la fois sur la conception du rapport au travail contenu dans ces outils et sur les changements qu’ils introduisent. Pour comprendre les causes de ces évènements, je partirai du concept de reconnaissance, central dans l’anthropologie, de son application aux suicides au travail et j’essayerai de voir ensuite la correspondance entre ces évènements et les outils de gestion. L’ensemble questionnant le devenir de l’enseignement diffusé dans les écoles de commerce.
Dans l’organisation des changements dans les entreprises, les objectifs déclarés des directions visent l’efficacité, souvent à court terme, et ne mentionnent que rarement, et toujours de façon vague, les références aux connaissances anthropologiques. On parle de l’homme, en général, on mentionne ses « besoins » en se référant trop souvent à des théories contestées dans le monde scientifique. Les références sérieuses aux sciences de l’homme, que j’ai nommées anthropologie pour le dire d’un mot, sont absentes. On précisera ici ce qu’est l’anthropologie, ou au moins les points qui influent ou peuvent influer le management.
Au préalable, il faut se mettre d’accord sur ce que l’on entend par management. Avec de nombreux praticiens, chefs d’entreprise, syndicalistes et consultants, je pense que la mission première du management est de faire travailler ensemble des hommes et des femmes. Si le terme de direction en général et, dans notre cas, celui de la direction d’une entreprise, consiste à choisir les orientations, décider des moyens à mettre en œuvre, etc., la fonction managériale s’en différencie en ce qu’elle s’intéresse, ou devrait s’intéresser, au premier rang, à faire travailler les membres de l’entreprise et à les faire travailler ensemble. (« la manière de conduire les hommes » selon Mc Gregor, célèbre consultant américain dans les années 60). Un manager est celui qui a en charge un groupe humain et doit le faire vivre. Ce qui est différent de ce que nous lisons trop souvent où le management est décrit comme un ensemble de techniques d’organisation et de gestion qu’il s’agit d’appliquer. Or ces outils sont mis en œuvre par des individus qui ont besoin tout à la fois de se coordonner dans le collectif pour accomplir leur travail et d’être reconnus pour le faire correctement. Pour mettre en œuvre ces outils, il est donc nécessaire d’être attentif aux efforts des membres du groupe, de prendre soin d’eux, de les aider à travailler en comprenant le sens qu’ils donnent à leur travail, à créer ou à améliorer les structures et les règles qui rendront ce travail efficace. C’est la fonction principale du manager.
1 – Théories de l’homme au travail : la reconnaissance
Je partirai du concept de reconnaissance parce qu’il est , selon ceux qui l’ont utilisé, au centre de toute relation humaine, il est un fondement du regard sur l’homme. Ce thème d’origine philosophique avec le philosophe Hegel a récemment repris des couleurs avec Renault et Dejours.
11 – Hegel en fait un thème central de sa philosophie. La postérité a retenu surtout la relation maître-esclave et le retournement de cette relation où, pour exister, l’esclave doit prendre la place du maître (d’où chez Marx, le déterminisme de la révolution, laquelle doit nécessairement arriver). Même si cette relation maître-esclave est importante, elle vient elle-même de la conception hégélienne de la société au fondement de laquelle il y a la lutte pour la reconnaissance : l’être humain est d’abord conscience de soi et cette conscience passe par la reconnaissance par les autres. “Les hommes n’ont pas, comme les animaux, le seul désir de persévérer dans leur être (…), ils ont le désir impérieux de se faire reconnaître comme conscience de soi, comme élevés au-dessus de la vie purement animale, et cette passion pour se faire reconnaître exige à son tour la reconnaissance de l’autre conscience de soi.“ (Hippolyte, 1948, p.163). Tous les actes de la société sont porteurs de cette attente de reconnaissance. Par exemple, le contrat présuppose que ceux qui le passent se reconnaissent à la fois comme personnes et comme propriétaires. La seule reconnaissance par le droit est insuffisante. De même, la « société civile » est le lieu où se satisfait le système des besoins définit comme la recherche d’être universellement reconnu, su et voulu. Enfin la culture, forme d’universalité de l’individu singulier, suppose que chaque individu soit conçu comme personne universelle. L’homme vaut parce qu’il est “homme“, non parce qu’il est juif, catholique, protestant, allemand, italien, etc, C’est lorsqu’il n’est pas reconnu comme “homme“ que peut naître une pathologie de la société, pathologie qui fait naître les exclus. Marx s’inspirera de ce passage dans la critique de la société bourgeoise comme productrice inéluctable de l’exclusion sociale.
La sphère du travail et celle de la satisfaction des besoins ne se réduisent donc pas au paiement d’un salaire ou d’autres éléments contenus dans le contrat de travail, mais incluent la nécessité de la reconnaissance de l’autre, comme homme. Cette reconnaissance, impliquée dans le contrat de travail liant l’ouvrier, le cadre, etc… à son entreprise, le déborde largement.
12 – Ce thème de la reconnaissance a été récemment repris par E. Renault (2004), qui s’appuie, entre autres, sur les travaux de Honneth (1992/2000). Pour ce dernier, ce qui fait l’originalité de la réflexion de Hegel sur ce thème est la mise en avant du rapport à autrui en tant que condition de la réalisation de la liberté. Non seulement la liberté ne se conçoit pas sans reconnaissance des uns par les autres, mais la société a le devoir de garantir cette capacité de reconnaissance. Ainsi, la justice, dans les sociétés modernes, se mesure à la garantie de la communication (liberté de la presse par exemple), à la possibilité pour chacun de rendre possible des rapports aux autres qui ne soient pas déformés. Ces rapports communicationnels sont des biens de base dont la disponibilité est une caractéristique des sociétés modernes. La notion d’«expérience communicationnelle» est censée rendre compte du fait qu’on ne se libère pas tout seul, mais avec autrui, dans un contexte qui comporte les instances de la société civile (c’est-à-dire monde du travail et des échanges économiques, État). La communication faussée crée l’expérience de l’injustice[1].
La question de la reconnaissance[2] pose un problème beaucoup plus général que celui des revendications politiques relatives à la différence : l’ensemble de nos rapports à autrui est traversé par des attentes de reconnaissance. L’image positive que nous pouvons avoir de nous-mêmes dépend du regard, des jugements et des comportements d’autrui à notre égard. C’est la raison pour laquelle nous restons toujours en attente de reconnaissance dans les interactions sociales. Pour préciser le sens de cette thèse, A. Honneth met en rapport trois formes de reconnaissance avec trois formes de rapport positif à soi, eux-mêmes distribués dans trois sphères sociales distinctes. La première sphère est celle de l’intimité. La reconnaissance y passe par l’amour et l’amitié, lesquels rendent possible la « confiance en soi », c’est-à-dire la conscience de la qualité de notre propre existence d’êtres de désirs et de besoins. La deuxième sphère porte sur les relations juridiques. La reconnaissance dépend alors des droits qui nous sont attribués et permettant le « respect de soi », à savoir la certitude de la valeur de notre liberté. La dernière sphère concerne la contribution de nos activités individuelles au bien de la société. La reconnaissance y a pour conséquence l’« estime de soi », entendue comme la conviction de la fonction sociale de notre activité. Ces trois sphères mettent en lumière les lieux de la reconnaissance et Honneth montre que, lorsque qu’il y a déni de reconnaissance dans ces sphères, on voit que ce déni est au cœur de l’expérience de l’injustice.
L’expérience de l’injustice sociale est toujours une expérience du mépris social, et, inversement, l’exigence de respect (lorsqu’elle répond à une situation de déni de reconnaissance) peut être considérée comme une demande de justice sociale[3]. En France, la question du respect s’est beaucoup développée dans l’espace public ces quinze dernières années, période durant lesquelles les inégalités, la précarité et le sentiment des discriminations se sont globalement accrues.
Le déni de reconnaissance est à la source du sentiment d’injustice, allant jusqu’aux luttes collectives et aux mouvements sociaux. Il est évidemment en lien avec le concept d’identité, produisant, selon Honneth, des lésions qui peuvent être paralysantes ou déstructurantes, comme le montrent les études psychosociales sur l’exclusion et la grande précarité. Les situations d’exclusion, en termes de précarité ou de désaffiliation, se traduisent par une perte des appuis sociaux de l’existence (perte de reconnaissance stable et valorisante) et par une insertion dans des relations sociales dépréciatives (reconnaissance dévalorisante ou stigmatisante). Ces deux types de reconnaissance pèsent sur le chômeur de longue durée, victime tout à la fois d’une diminution et d’une fragilisation de ses relations sociales valorisantes (travail, famille, cercles relationnels divers), ainsi que de différentes formes de stigmatisation liées aux représentations sociales du chômage et aux interactions avec les services sociaux. Dans la grande précarité, le clochard vit dans une constante insécurité sociale et dans une confrontation permanente avec l’humiliation et la violence extrême.
Ces difficultés tiennent au fait que le rapport positif à soi dépend, pour une large part, de la reconnaissance interindividuelle. Absence de reconnaissance ou reconnaissance dépréciative peuvent provoquer cette fragilisation du rapport positif à soi, couramment désignée par la catégorie de « mal-être ». Elles peuvent aller jusqu’à un rapport négatif à soi, se traduisant en intériorisation de la honte, voire en destruction du rapport à soi. Le chômage de longue durée, tout autant que la non reconnaissance de son travail, peut conduire de nombreux individus à s’attribuer la responsabilité de la situation dans laquelle ils se trouvent, à s’identifier eux-mêmes à des « ratés » ou à des « bons à rien ». Et du coup à aller jusqu’à la négation totale de sa personne s’accompagnant de phénomènes extrêmes comme les suicides, qui sont apparus récemment dans le cadre professionnel du travail.
13 – On doit à Christophe Dejours (1980), psychiatre et psychanalyste, d’avoir souligné toute l’importance de la reconnaissance interindividuelle dans l’activité professionnelle. Tout travail étant, selon Dejours, générateur de souffrance, le travail ne peut remplir une fonction psychique positive pour l’individu qu’à condition qu’il parvienne à transformer cette souffrance en plaisir. La reconnaissance par les collègues et la hiérarchie joue un rôle non négligeable à cette fin. Mais la reconnaissance de la réalité et de l’utilité du travail conditionne également la coordination des différentes activités : la coopération dans le travail dépend donc aussi de la reconnaissance. Si les composantes psychologiques et sociologiques de l’activité de travail font intervenir une problématique de reconnaissance, C. Dejours montre également que le sentiment d’injustice est souvent référé par les salariés à un manque de reconnaissance. À l’heure où le nouveau management utilise la promesse de reconnaissance comme une technique de gestion du personnel, voire de domination, la question de la reconnaissance devient brûlante, et exige sans doute de distinguer reconnaissance véritable et « reconnaissance comme idéologie ».
La reconnaissance est une rétribution symbolique essentielle que Dejours met dans le cadre de la dynamique contribution-rétribution. Sans elle, le sujet se démobilise, travaille à contre-cœur, ce qui a des conséquences graves pour sa santé mentale. Sans reconnaissance, c’est bien le système de valeurs associé au travail qui est systématiquement attaqué. Ainsi, la flexibilité (interim, CDD), synonyme de non-reconnaissance ou d’une faible reconnaissance, affaiblit le pouvoir de résistance des salariés et des métiers, pas seulement car elle introduit à la précarité et aux licenciements. Les outils de gestion peuvent provoquer aussi un déni de reconnaissance.
14 – Conclusion de ce paragraphe sur la reconnaissance. Ce thème de la reconnaissance a été envisagé sous deux aspects et aboutit à deux conclusions sensiblement différentes. Pour les philosophes, Hegel, Honneth et Renault, la reconnaissance fonde toute l’anthropologie. L’être humain est d’abord relation et c’est dans la relation qu’il existe. Sans elle, il n’y a tout simplement pas de vie humaine possible, les totalitarismes l’ont bien montré lorsqu’ils ont nié la qualité d’homme à certaines catégories. Il en est de même dans le monde du travail et dénier toute reconnaissance à un être revient à lui dénier le droit d’exister. Dans la seconde perspective, celle de Dejours, la reconnaissance est une des composantes du sujet, elle permet de transformer la souffrance en plaisir et elle accroît l’identité. Le travailleur attend un jugement sur son travail et sur la qualité de ce travail et si ce jugement est négatif, il augmente la souffrance sans remettre en cause l’existence même de l’individu. Dans ce cas, la stratégie de demande de reconnaissance relève d’une stratégie de défense, dans l’autre, celle des philosophes, elle est une contrainte nécessaire pour devenir soi-même.
2 – Reconnaissance et suicide
Les suicides au travail qui ont récemment ému l’opinion publique ont été d’abord attribués à des causes comme le stress, les conditions de travail, les changements d’organisation. Or de nombreuses approches lient le suicide au thème de la reconnaissance. Je développerai d’abord cette approche pour revenir ensuite sur les causes habituellement invoquées.
21 – Une des plus anciennes analyses du suicide, celle de Durkheim (1897), attribue le suicide à la perte de reconnaissance sociale. Il en fait une conséquence du phénomène de non-reconnaissance, évoqué plus haut. Durkheim veut étudier le phénomène du suicide parce que celui-ci a, entre autres, les apparences d’un fait strictement individuel. C’est, en effet, un individu qui décide, seul, de mettre fin à sa propre vie. Or Durkheim montre, dans cette étude, que ce fait est tout autant un fait social. Il est le résultat d’une relation sociale caractérisée par l’absence de reconnaissance ou par une reconnaissance dépréciative. L’équilibre de la personnalité dépend de la densité des liens entre l’individu et la société. Dans son étude sur le suicide, il a montré que les taux de suicide sont liés aux contextes sociaux, sous leur aspect de contraintes normatives. Le fait que ces contraintes soient trop faibles ou trop élevées déclenche une propension au suicide, indépendamment de tout autre considération, en particulier du caractère de l’individu.
« Ce qui le (le suicide égoïste) caractérise, c’est un état de dépression et d’apathie produit par une individuation exagérée. L’individu ne tient plus à être, parce qu’il ne tient plus assez au seul intermédiaire qui le rattache au réel, je veux dire à la société » (Durkheim, le suicide, p.406, PUF, ed 1960). « Le suicide varie en raison inverse du degré d’intégration des groupes sociaux dont fait partie l’individu. » (p.223) (…) « Quand ils (les individus) sont solidaires d’un groupe qu’ils aiment, pour ne pas manquer à des intérêts devant lesquels ils sont habitués à incliner les leurs, ils mettent à vivre plus d’obstination. Le lien qui les rattache à la cause commune les rattache à la vie (…) Dans une société cohérente et vivace, il y a de tous à chacun et de chacun à tous un continuel échange d’idées et de sentiments et comme une mutuelle assistance morale, qui fait que l’individu, au lieu d’être réduit à ses seules forces, participe à l’énergie collective et vient y réconforter la sienne quand elle est à bout » (p.224).
S’il existe un lien entre les crises économiques et le taux de suicide, ce n’est pas seulement ni surtout parce que ces crises créent de la pauvreté, ou que les pressions de productivité y sont plus fortes, c’est parce que les liens qui relient les individus sont distendus. Si la pauvreté est partagée, le lien social n’est pas rompu, tous sont dans la même situation et les crises provoquent autant de solidarité que de repli sur soi. Si les taux de suicide augmentent, c’est que dans cette situation, les individus ne se sentent plus reliés aux autres et ne ressentent plus les liens qui les relient aux autres. « Si donc les crises industrielles ou financières augmentent les suicides, ce n’est pas parce qu’elles appauvrissent, puisque des crises de prospérité ont le même résultat ; c’est parce qu’elles sont des crises, c’est-à-dire des perturbations de l’ordre collectif. » (p.271)
Il est étonnant qu’aucune référence à cette analyse (à la date de janvier 2010), fondée sur une étude des comportements de suicide, n’a retenu l’attention des observateurs au moment où de nombreux suicides ont fait la une des médias[4]. En effet, si grand bruit a été fait récemment autour des suicides au travail, je n’ai pas lu de références à ce travail mondialement connu de Durkheim, travail qui est considéré comme fondateur de la sociologie, de la discipline sociologique. Beaucoup a été écrit sur les fragilités psychologiques, sur le stress au travail, sur l’organisation du travail et ses changements incessants. Or Durkheim, quelles qu’aient été les critiques méthodologiques adressées par la suite à cette étude pionnière, a montré que le suicide est le résultat d’une situation de non-reconnaissance par la société, concrètement par le groupe social le plus proche, par le groupe de travail. Durkheim a choisi le suicide comme exemple d’une action qui semble individuelle et qui, en fait, est étroitement liée au phénomène de reconnaissance sociale. Pour caractériser la situation permettant ou poussant au suicide, il a construit le concept d’anomie, l’opposant à celui d’intégration.
22 – Christophe Dejours (2009), insiste sur la relation au collectif. Il met au centre de l’explication du suicide une évolution des rapports de l’individu au travail avec le collectif de travail. Pour lui, un seul suicide est le signe du délitement d’une relation entre tous les membres du collectif.
Par ailleurs, Dejours affirme que, dans tous les cas dont il a eu l’écho, aucune investigation clinique n’a eu lieu après le suicide. Cela signifie le refus d’élucidation des causes du suicide, le refus de recherche de transformation de l’organisation du travail, des rapports entre salariés ni avec la hiérarchie. On continue comme si de rien n’était. C’est un déni du suicide. En l’absence de réaction collective, les sentiments d’impuissance, de résignation voire de désespoir, s’accroissent.
Sur le lien entre suicide et travail, Dejours relève trois approches. Le stress est la plus répandue. Dans ce cas, le suicide est attribué à la fragilité de l’individu, malgré le poids de l’environnement. La gravité de la perturbation dépend de la manière dont l’individu gère son stress. Cette approche écarte de fait l’environnement, le réduit au coping out (gérer, se débrouiller).
La seconde approche est dite « structuraliste » (malgré l’ambiguïté du terme). Ici, on parle des facteurs héréditaires et génétiques. On reste du côté psychologique, le travail servant de révélateur des failles de l’individu.
Dans la dernière approche dite « sociogénétique » le travail et ses contraintes sont décisives. Ce sont les méthodes de gouvernement d’entreprise, management, organisation du travail, outils de gestion qui ont un impact majeur.
Dans ces trois approches, le suicide serait la conséquence d’une disqualification de la contribution que l’individu apporte à l’entreprise et de son mérite. Parmi les motifs les plus souvent invoqués, il y aurait le refus de proposition de mutation ou de promotion, refus interprété par la hiérarchie comme un acte de résistance alors qu’on attendait une disponibilité totale. Ou, autre motif, les réformes de structure, les changements dans l’organisation, le besoin de licencier. Dans ce dernier cas, il s’agit de trouver des prétextes pour déstabiliser les gens, leur faire faire une erreur qui les fait s’auto-accuser et les pousse au suicide. Ces approches mettent en lumière le fait que la vulnérabilité psychologique ne peut être tenue pour une cause déterminante des suicides, elle existe mais est liée à des causes environnementales.
Le travail et ses contraintes sont les moyens par lesquels passent toutes ces approches du suicide. Dans celle de Dejours, le lien social apparaît de façon secondaire, c’est davantage le lien avec des situations de travail difficiles qui est cause des suicides et l’absence de reconnaissance sociale est une retombée de ces situations. Pour Durkheim et, de manière indirecte, pour Hegel, a perspective de la reconnaissance existe en elle-même.
3 – Les changements dans la gestion, causes des suicides ?
Les outils de gestion mis en place depuis une vingtaine d’années ont eu deux caractéristiques principales : nouveaux modes de mesure et de quantification, application à l’individu hors du collectif de travail[5]. En rappelant que tout outil de gestion est porteur de sens. Par exemple, mettre en place des systèmes jugeant les individus sur leurs performances individuelles revient à considérer l’être humain comme un individu isolé, une monade leibnizienne qui vit dans un univers sans contact avec les autres. La phrase, si souvent entendue dans les milieux de l’entreprise, « L’entreprise, ce sont des hommes » contient un sens caché, à savoir qu’il est possible de parler des hommes hors de tout contexte social. « L’entreprise, ce sont les relations entre les hommes » propose une vision beaucoup plus réaliste de la vie de tout groupe humain.
31 – Quand l’outil remplace l’homme et ignore la reconnaissance
Que s’est-il passé depuis quelques années? La plupart des observateurs s’accordent pour dater de la fin des années 80 ce qu’ils nomment le tournant gestionnaire. À partir de cette période, de nouvelles méthodes de gestion sont mises en place dans les entreprises, méthodes dont la finalité dans un contexte de concurrence exacerbée est surtout d’augmenter la productivité. Ces méthodes se veulent universelles, quelles que soient les situations concrètes de travail. Elles consistent en nouveaux instruments de contrôle introduits, entre autres, sur le poste de travail. On passe à une évaluation quantitative par comptage et mesurage, le recours à ces méthodes quantifiées ne laissant que peu de place à l’appréciation de la qualité par les individus. Or cette appréciation vient de leur expérience quotidienne, ils y tiennent car elle prend en compte les particularités de chaque situation. L’universalité de l’outil et de ses méthodes de mesure, fait entrer les outils de gestion en lutte contre le métier. On passe de la référence au travail à la référence à la gestion. Les gens de métier, expérimentés, ceux qui formaient l’encadrement intermédiaire, sont remplacés par des diplômés en gestion. L’expérience est reléguée au profit de systèmes de normes. À cela s’ajoute le mouvement massif des transferts à la sous-traitance, qui se fait aussi à travers les normes et les règles sans qu’il y ait véritablement transmission de la pratique du métier.
Les systèmes de normalisation se multiplient et se généralisent. Les plus connus portent sur la qualité (ISO 9000 et la suite). Ils touchent tous les systèmes de travail et de production, concernent les produits, le développement dit durable, les normes sociales, etc… Il s’agit aussi de programmes de réorganisation comme le reengineering, downzising, benchmarking, les systèmes de gestion informatisés, dont le plus connu est l’E.R.P. Ces systèmes de normalisation se veulent objectifs et objectivables[6], ce qui, depuis le début de l’ère industrielle, a été le mythe de la rationalisation, du calcul, et de la prévision. Or, le mode d’objectivation taylorien est en cours de dissolution. D’une part en raison du « retour en force de pratiques et de représentations qu’il est impossible d’arrimer à des référentiels “objectifs“ au sens de l’ingénieur taylorien » (Veltz, p162). D’autre part, la distance entre l’élaboration des normes et leur mise en œuvre s’est considérablement agrandie. Le savoir-faire des exécutants n’est pas ou peu présent dans l’élaboration des normes dont la portée doit être universelle. L’écart entre les systèmes de normes et leur application devient de plus en plus important.
Dans le cas de l’évaluation des performances des individus ou des groupes, on voit cet écart entre l’objectif d’impartialité de jugement accordé à ces systèmes et la réalité. Cette impartialité, venue de la prétention universaliste de la mesure des performances, est rendue très difficile et aléatoire du fait de la multiplicité des variables qui influent sur elles. Par exemple, il a été montré que les performances attendues d’un investissement ou d’un changement organisationnel peuvent être sur- ou sous-évaluées de manière conséquente. Le benchmarking, tant prisé, vient des difficultés des mesures objectivables et donc du recours obligé à des comparaisons et à des imitations toujours difficiles à réaliser.
Il existe de très nombreux outils de mesure de l’efficacité et de ratios. Mais « l’efficacité économique se constate souvent ex post, sans que l’on soit capable d’en suivre la genèse, dès lors que cette efficacité résulte de processus impossibles à formaliser tels qu “la capacité de diagnostic d’une installation complexe par un collectif d’opérateurs“ ou “la pertinence des communications non formelles dans un réseau“ » (Veltz, p.147). Un exemple en a été donné dans une étude portant sur les salariés d’un laboratoire de recherches qui ont reçu l’injonction d’appliquer les normes ISO sur la qualité. Ils résistent à cette injonction car ils estiment appliquer déjà des critères de production de la qualité. Ces nouvelles règles leur semblent en contradiction avec leurs pratiques, celles-ci consistant en des espaces de parole institués et des ajustements locaux que les experts chargés de mettre en place ISO ne connaissent pas. Ils n’ont ni un savoir commun partagé, ni un savoir « décalé » (savoir sur le savoir de l’autre). Ils ne sollicitent pas la dimension collective des pratiques alors qu’elle est centrale pour l’élaboration des produits. Tant que ce système de pratiques collectives n’est pas pris en considération, le modèle ISO ne peut fonctionner. Il a été conçu comme un modèle idéal, fondé sur une image générale des pratiques des individus et ne parvient pas ou très difficilement à prendre en compte les particularités des situations ainsi que la dimension collective, qui est pourtant à la base de la réussite de l’équipe de ce laboratoire (Bernoux, 2010, pp.187-89).
Ce qui se dégage des observations faites sur l’application des outils de gestion est que l’impartialité de jugement est le plus souvent illusoire, qu’ils ne peuvent pas prendre en compte les situations concrètes et qu’ils ignorent les collectifs de salariés. Fondés sur l’appréciation du seul individu, non de l’individu en situation de travail dans un collectif, ils ne peuvent atteindre l’efficacité dont ils se targuent. Celle-ci, de plus, serait multipliée s’ils s’implantaient de manière interactive et non par la seule pression de la hiérarchie ou de leur logique. En effet, les études montrent que la mise en place de ces outils se peut se faire que dans une relation de négociation et d’échange, pas par imposition. La réussite n’a lieu que dans la mesure où tous ceux qui ont à faire avec ces changements sont considérés comme de véritables acteurs dans leur réseau de relations. Même lorsqu’il s’agit des outils les plus sophistiqués, ces acteurs savent se créer des marges de liberté. Les théoriciens de l’école de la traduction (Callon, Latour, 1991) l’ont montré en mettant en lumière le poids des réseaux et leur construction, c’est-à-dire le poids des systèmes de relations. Il faut ajouter, que les acteurs ayant affaire aux normes sont nombreux, que la construction des normes n’obéit pas uniquement à une logique technique mais qu’elles sont un construit social où interfèrent les relations sociales, politiques, de travail . Les auteurs parlent de réseaux socio-techniques. La rédaction des normes n’obéit pas seulement à la construction d’un compromis entre acteurs, mais le processus de normalisation réside précisément dans le tissu de liens qui existe entre le texte et les différents protagonistes. La normalisation n’existe que dans ces liens entre les normes elles-mêmes, ceux qui les portent, et la volonté des acteurs qui doivent l’appliquer.
32 – Quand l’outil détruit le collectif
Un des principaux outils de gestion concerne le modèle de la compétence et celui de l’évaluation des individus. Au cours des cinquante dernières années, on est passé du modèle de métier (classement des emplois selon la grille Parodi-Croizat) à un modèle du poste de travail (ce n’est plus l’individu mais le poste qui est classé) pour arriver aujourd’hui au modèle de la compétence. C’est un « recentrage sur l’individu, ses capacités, ses potentialités, et non sur la définition objectivée d’un poste impersonnel » (Veltz, p.166). L’individu peut ne plus être payé en fonction de la tâche qu’il accomplit, il le sera alors selon son niveau de compétence. Or l’évaluation de la compétence est difficile et pleine d’aléas. Ce n’est pas seulement une capacité à faire, mais une aptitude à juger et à décider. Elle s’appuie sur des savoirs et une expérience. Le nombre des méthodes mises en place dans les entreprises censées évaluer les compétences est la preuve de la difficulté à le faire, car la compétence inclut les capacités relationnelles, communicationnelles, comportementales, etc. Surtout, elle prétend évaluer les capacités relationnelles sans qu’apparaisse ni le groupe ni l’ensemble des individus auprès desquels doivent s’exprimer les individus évalués. S’il n’est pas possible de mesurer la reconnaissance que ses pairs donnent à l’individu, que vaut la mesure de la capacité relationnelle ? L’idée de compétence relationnelle est pertinente, mais on sait mal ce que mesurent les outils de mesure adoptés par les systèmes d’évaluation.
Selon la perspective de Dejours (2009), le système de valeurs associé au travail est systématiquement attaqué à travers l’évaluation individualisée des performances. Pour plusieurs raisons. D’abord, parce que ce moyen se présente comme une méthode objective d’évaluer le travail de chaque individu et de le comparer aux autres. Peut-on le qualifier vraiment d’objectif et d’outil d’évaluation ? Dejours ne le pense pas car ce moyen repose de plus en plus sur des compétences relationnelles, impossibles à mesurer objectivement, en particulier dans les services. Ensuite et surtout pour ses conséquences sur le travail collectif, la coopération et le vivre ensemble. L’évaluation individualisée des compétences, introduisant de la concurrence entre salariés et même entre services, se traduisant souvent en termes de gratification, fait pâtir la qualité des relations entre individus et entre services et, in fine, la coopération. Chacun se retrouve seul. La reconnaissance ne peut avoir lieu, les individus se sentent isolés, on aboutit à une destruction mortifère du lien social. Les suicides ne résultent pas des injustices ou du harcèlement ou de la disgrâce, mais viennent du silence des autres, de leur abandon ou de leur lâcheté, voire de leur trahison.
Finalement le privilège accordé aux critères de gestion sur les critères de travail par les nouvelles méthodes ont déstructuré le monde du travail, ont cassé les ressorts de la coopération et de la solidarité. Elles ont abouti à détruire la santé mentale des individus ainsi que la qualité du tissu social.
4 – Les choix implicites des théories du management
Pourquoi les outils gestionnaires n’impliquent-ils pas l’approche par la reconnaissance ni par le collectif ? Pourquoi sont-ils centrés sur les individus, sans prise en compte réelle de ses relations aux autres salariés, au collectif de travail ? En l’absence de recherches approfondies sur le sujet, je propose des hypothèses fondées sur mon expérience personnelle. Il y aurait là matière à un véritable programme de recherches.
L’hypothèse est la suivante : faute d’avoir une formation suffisante en sciences humaines, les responsables se déterminent en fonction du paradigme le plus visible, le plus appréhendable et, dans la littérature managériale, le plus souvent mentionné des raisons du comportement humain, celui de l’individu et de ses besoins.
En voici un exemple récent. Des collègues de mon laboratoire mènent une grosse enquête dans des centres techniques d’un organisme de la fonction publique. Celui-ci est confronté à un changement important de métier : celui qui était exercé traditionnellement est condamné à disparaître au profit d’une orientation profondément différente. Ce changement ira de pair avec des mutations et un plan social qui, cependant, se fera à travers les départs à la retraite non remplacés, aucun salarié ne perdant ni son emploi, ni son salaire. Or l’enquête révèle un profond malaise parmi les salariés. Le directeur ne comprend pas : ils gardent et leur emploi et leur salaire ; de quoi se plaignent-ils ? Et d’attribuer le malaise à la résistance naturelle au changement. Il ne comprend pas que le problème est ailleurs, dans un attachement au métier qui constitue l’essentiel de la reconnaissance sociale des salariés. Le métier antérieur, ils savaient le faire et en tiraient une grande fierté. En changer équivaut à perdre la reconnaissance sociale, essentielle pour, professionnellement, être eux-mêmes, garder leur « conscience de soi ».
Pourquoi continue-t-on à enseigner la pyramide de Maslow dans certaines grandes écoles françaises, écoles dont sortiront les futurs directeurs et élites dirigeantes ? Pourquoi la théorie X de D. Mc Gregor[7] continue-t-elle à imprégner les programmes de formation au management ? Pourquoi les programmes d’instituts de formation au management sont-ils aussi pauvres en réflexion sur les sciences humaines ? Dans le programme d’un institut réputé qui propose une semaine de formation, on trouve : un point sur les acquis de l’individu, sur l’ingénierie de base, sur les neurossciences, sur les pratiques concrètes de l’entretien, sur les motivations, sur les pratiques, etc., mais rien sur l’homme au travail, sa place dans le collectif, etc. Je fais l’hypothèse que cette absence est contenue dans la philosophie qui imprègne ces programmes : se centrer sur l’individu, sur ce que l’on croit être ses attentes, ou ses besoins. La formation aux éléments principaux d’une science de l’homme dont j’ai donné ici deux composantes principales est absente. Reconnaissance sociale et collectif sont rarement mentionnés dans les programmes de formation. Les enseignants pensent-ils qu’il est plus facile et plus accessible aux auditeurs, futurs responsables, de partir de l’individuel et de ses supposés besoins ? Le faire rend sans doute le contact plus facile et immédiat. Mais c’est ainsi que se préparent les catastrophes humaines.
Conclusion
Les principes du management des hommes, qu’il s’agisse des sociétés ou des entreprises, obéissent à des représentations à priori. Ces représentations sur la nature humaine orientent la pensée des dirigeants, managers et consultants et les structures que ces responsables mettent en place en sont dépendantes tout autant que des contraintes économiques ou technologiques. Mettre en place des structures de concertation entre managers et salariés, ou bien laisser le manager décider seul pour ensuite faire part de ses décisions, sont deux manières opposées de gérer les groupes et de donner sens au travail. Ces structures différentes ne sont que très rarement “imposées“ par les contraintes externes. Elles sont le produit d’une vision de l’individu portée plus ou moins consciemment par les dirigeants. Or ces structures jouent un rôle fondamental pour favoriser l’intérêt au travail ou en faire un repoussoir, motiver ou démotiver les individus, faire éclater les collectifs de travail ou au contraire aider les salariés à se sentir membres d’un ensemble humain, etc. Les outils de gestion ne sont pas que des outils destinés à mieux gérer. Les outils de gestion donnent du sens. Il vaut la peine de s’interroger sur le sens qui est donné.
Bibliographie
– Bernoux Ph., (2010, 1ère ed 2004), Sociologie du changement dans les entreprises et les organisations, Paris, Seuil, coll, essais, poche
– Callon M., Latour B., ss la dir de, (1991), La science telle qu’elle se fait, Paris, La Découverte
– Dejours C., (1980), Travail, usure mentale – De la psychopathologie à la psychodynamique du travail, Bayard éditions, Paris, nouvelles éditions augmentées en 1993 et 2000, 281 p.
– Dejours C. (2009), Suicide et travail, que faire ? Paris, PUF, coll Souffrance et théorie, 130p
– Hippolyte J., (1946), Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel, Paris, Aubier-Montaigne,
– Honneth A., (1992, trad fcse 2000), La lutte pour la reconnaissance, Paris, ed du Cerf,
– Honneth A., (2008, 2006), La société du mépris, Paris, La découverte poche
– Mc Gregor D., (1960/69 pour l’ed. fsce), La dimension humaine de l’entreprise, Gauthier-Villars
– Mallard A., (2000), L’écriture des normes, réseau n°102, France Télécom R&D/Hermès
Science Publication
– Postel N. et al., (2010), « La RSE : une nouvelle forme de marchandisation ? », L’économie politique, n°45, pp. 83-97
– Renault E., (2004), L’expérience de l’injustice. Reconnaissance et clinique de l’injustice, Paris, La Découverte (Armillaire), 412 p.,
– Sainsaulieu R., (1977), L’identité au travail, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 487 p.
– Veltz P., (2008, 1e ed 2000) , Le nouveau monde industriel, Paris, Gallimard, coll. le débat
[1] Ce point de départ différencie Honneth de Rawls (les biens premiers et le consensus) et de Habermas (l’agir communicationnel).
[2] Je m’inspire ici en particulier de l’article de E. Renault, « La lutte pour la reconnaissance », Sciences Humaines, n°132
[3] Ce qui est à la base du comportement protestataire est l’expérience d’atteintes aux idées de justice, au respect de la dignité, de l’honneur, de l’intégrité propre. C’est le sentiment de subir une mépris social (Honneth, 2008, pp.192-93)
[4] Après que ce texte a été écrit, je lis dans n° de Janvier 2010 de la revue Alternatives Economiques, une excellente référence au livre de Durkheim.
[5] A partir de 1980, on assiste à une progressive remise en cause du contrat de travail à durée indéterminée comme norme salariale ainsi qu’au durcissement des conditions d’accès aux différentes protections sociales. Il s’agit de replacer la relation salariale sous l’égide du seul marché (Postel, 2010).
[6] Je m’inspire dans ce § de Veltz, op cit. pp.160 ss.
[7],L’auteur, analysant les programmes de formation et les comportements de managers ayant suivi ces formations aboutit à deux conclusions. D’abord, que les résultats de la formation sont peu dépendants du contenu de la formation. Ils dépendent beaucoup plus de la conception que la direction se fait de la tâche de dirigeant : les cadres formés changent leur mentalité surtout en fonction de ce qu’ils savent de la politique de la direction. Or cette politique est essentiellement fonction d’un ensemble d’hypothèses implicites sur la nature humaine. D’où, seconde conclusion, l’énoncé des fameuses théories X et Y. La première, la théorie X, celle qui inspire la très grande majorité de ces programmes, s’énonce en trois points : 1/ L’individu moyen éprouve une aversion innée pour le travail, qu’il fera tout pour éviter 2/ À cause de cette aversion, les individus doivent être contraints, contrôlés, dirigés, menacés de sanctions, si l’on veut qu’ils fournissent les efforts nécessaires 3/ L’individu moyen préfère être dirigé, désire éviter les responsabilités, a relativement peu d’ambition, recherche la sécurité avant tout.